Sainte-Chapelle royale de Paris
Nul besoin de se mobiliser spécialement ce week-end de septembre pour découvrir, ou plutôt redécouvrir les merveilles du patrimoine qui sont à notre portée et pour lesquelles il faudrait vivre bien plus d'une vie de loisirs pour toutes les visiter. Je regardais hier la queue des candidats à la visite de l’hôtel Matignon, rue de Varenne … Il est évident que les lieux de pouvoir fascinent. Mais cela doit être hyper fatigant !
Nos pas nous avaient conduits cette semaine aussi à faire environ une heure de queue pour admirer la Sainte Chapelle. Mais le contrôle est effectué par la gendarmerie, puisque ce joyau unique de l’art gothique est enchâssé dans l’une des cours du Palais de Justice, l’ancien palais du roi de France. La file d’attente avance cependant de façon régulière et l’émerveillement en vaut largement la peine.
Je ne me souvenais plus très bien de ma précédente visite, avec mon père, il y plus de cinquante ans. Finalement, ce qui nous a incité à y revenir, c’est la restauration des vitraux et une certaine émission de télévision … Voilà ce qui constitue la véritable culture populaire.
Quelques étonnements de nature politico-économique : la chapelle a été édifiée entre 1242 et 1248(seulement !) pour abriter les saintes reliques (la couronne d’épines du Christ, des fragments de la vraie croix, etc …) achetés à prix d’or par Louis IX après les avoir négociées pendant plus de deux ans auprès de Baudoin II de Courtenay. On évoque le prix de 135000 livres tournois en 1238 soit la moitié du revenu du domaine royal. Et davantage que le coût de la Chapelle elle-même. Comme quoi, les dépenses somptuaires, engagées aux fins de propagande pour faire de Paris une nouvelle Jérusalem remontent à bien plus longtemps que les manies architecturales de nos hommes politiques. Aujourd’hui, le dada, ce sont les Jeux Olympiques …
Faisons abstraction des restaurations importantes dont le monument a bénéficié, en particulier au XIXème siècle, sous la responsabilité de Félix Duban (le même qui réinterpréta le château de Blois). Pour l’extérieur, sachons que les portails sont dus au sculpteur Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume, et que la nouvelle flèche, savamment ouvragée, fut dessinée en 1850 par Lassus et réalisée selon les techniques du Moyen-Âge.
On a donc deux chapelles superposées : une basse, où venait prier le peuple, et une haute destinée au roi. En bas, on a réinventé la polychromie des murs telle qu’elle devait apparaître au Moyen-Âge dans toutes les églises …
Ce qui est dommage, c’est que l’espace est actuellement occupé par les boutiques de souvenirs qui nuisent à une saine préparation au choc artistique de l’espace supérieur. En haut, c’est l’élégance de la voûte qui prime. Pour obtenir une si grande hauteur, on aura remarqué à l’extérieur les contreforts verticaux pourtant très discrets malgré leur masse et, grande novation au XIIIème siècle, un chaînage métallique transversal invisible car noyé dans les interstices des verrières.
Le choc est garanti au débouché de l’escalier en colimaçon conduisant à la chapelle haute : tout est légèreté, envolée, couleurs et ors. Il y a 1113 panneaux comme suspendus qui furent réalisés en moins de quatre ans, disposés en 15 verrières de 15,35 m de haut sur 4,25 m de large. L’agencement de chacune des verrières est différent : des losanges, des formes quadrilobées, des carrés, des mandorles … Des scènes de la bible, évidemment, et de l‘invention des saintes reliques par Hélène, mère de l’empereur Constantin, des combats, des chevaliers en armures …
Toute l’iconographie des croyants du temps des cathédrales, en technicolor de l’époque : les matières tinctoriales utilisées étaient alors le cobalt pour le bleu, le cuivre pour le rouge et le vert, le manganèse pour le pourpre, l’antimoine pour le jaune, la grisaille pour les visages et les détails.
On ne sait plus où poser le regard, c’est gai, vivant, pas très solennel : une fête pour l'esprit qu'il faudrait avoir le temps de détailler et qui laisse les spectateurs quasiment muets.
Bien plus recueillis qu’à la Chapelle Sixtine, selon mon souvenir.

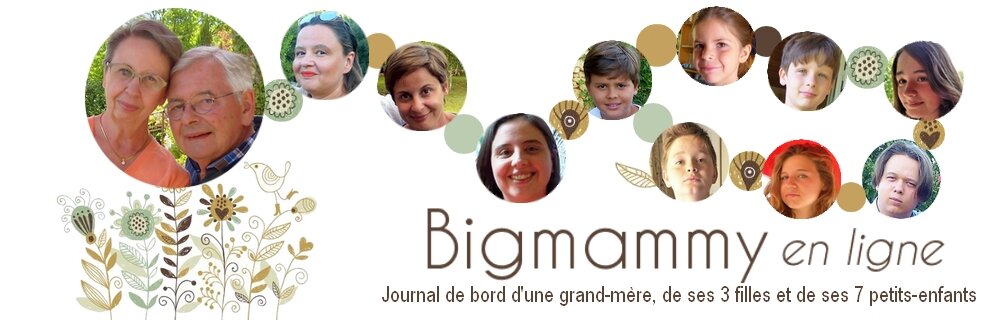
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F0%2F305202.jpg)


















/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F93%2F95%2F363481%2F133586725_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F31%2F13%2F363481%2F133559718_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F27%2F54%2F363481%2F133554915_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F16%2F59%2F363481%2F133541882_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F02%2F18%2F363481%2F46689756_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F82%2F61%2F363481%2F127956427_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F40%2F363481%2F130024007_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F16%2F75%2F363481%2F128171222_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F94%2F04%2F363481%2F38406292_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F16%2F363481%2F22700071_o.jpg)